45 rue des Saints-pères Paris 6e
![[JE] Penser la Palestine à travers les sciences sociales @ Amphi Giroud - Campus St Germain des prés](https://www-test.u-pariscite.fr/societes-humanites/wp-content/uploads/sites/20/2024/01/Colloque-300x169.jpg)
Co-organisée par l’Atrium Humanités et Sciences Sociales de l’université Paris Cité, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche, dans le cadre du projet structurant FIRE-UP (programme d’Investissements d’avenir, ‘ANR-21-EXES-0002’), et des doctorant.es de la Faculté Sociétés & Humanités, cette journée d’étude réunira des chercheur.es, juristes, historien·nes, sociologues, anthropologues, et psychiatre.
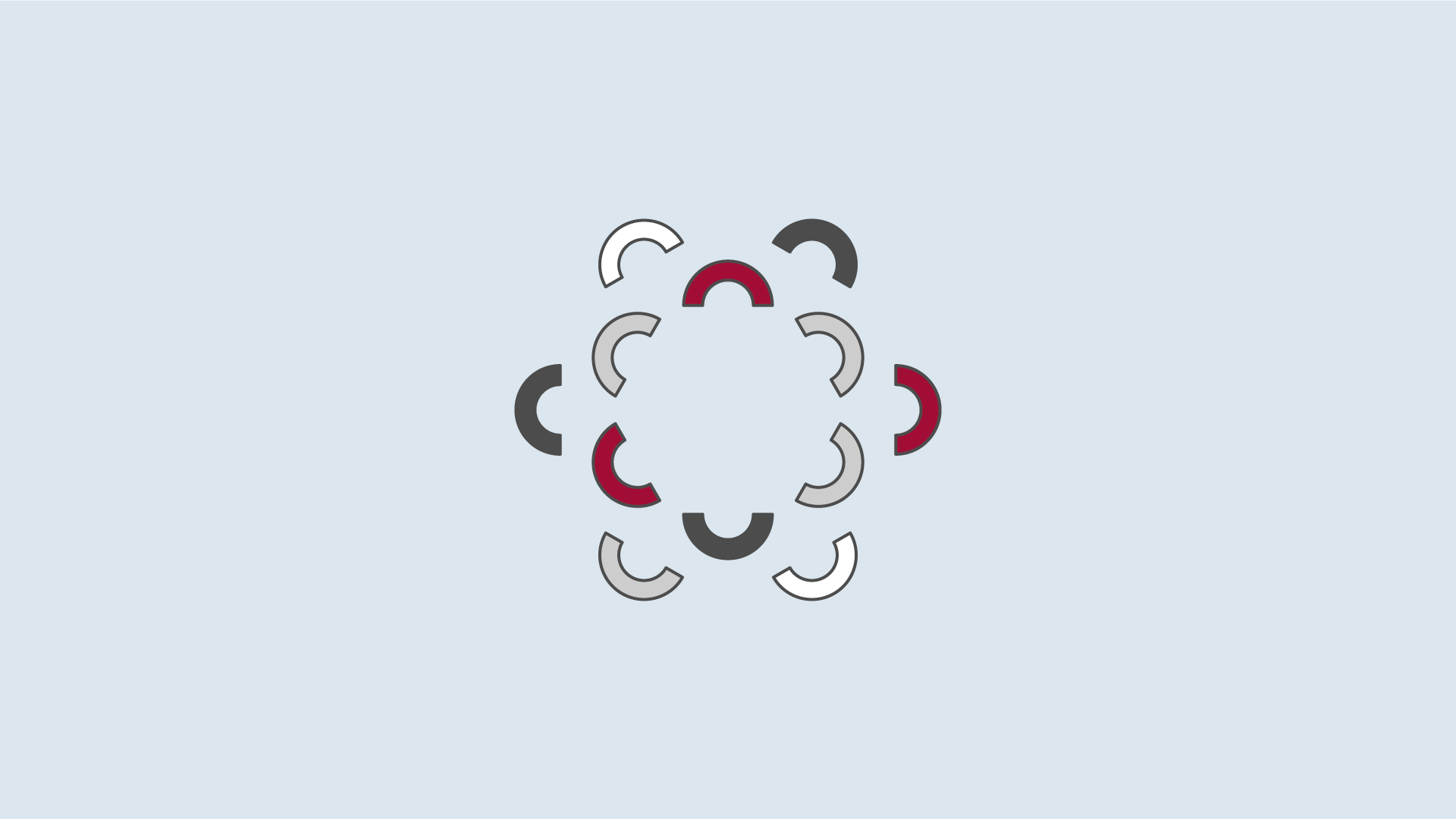
PROGRAMME
9h-9h15 : Accueil et café
9h15-9h30 : Mots de bienvenue
Marie Salaün, Vice-Doyenne Recherche Faculté Sociétés et Humanités, Université Paris Cité
Valérie Robin Azevedo, Directrice scientifique de l’Atrium Humanités et Sciences sociales, Université Paris Cité
9h30-10h00 : Keynote
Abaher El-Sakka, professeur de sociologie à l’Université de Birzeit (Palestine)
« Le monde post-octobre 2023 : repenser nos références conceptuelles en sciences sociales »
10h00-12h00 : Table 1. La colonisation et l’occupation militaire israéliennes de la Palestine. Perspectives pluridisciplinaires
Modération : Sarah Cassella, professeur de droit public, Université Paris Cité – Centre Maurice Hauriou.
lntervenant·es :
- Insaf Rezagui, doctorante en droit international à l’Université Paris Cité, chercheuse associée à l’lFPO : « Cadre, règles et mécanismes juridiques applicables et mobilisés dans le contexte de l’occupation »
- Taher Labadi (visio), chercheur à l’lFPO Jérusalem : « Produire et travailler en Palestine en situation coloniale »
- Souha Mansour, pédopsychiatre. Responsable du Centre Médico-psychologique de Saint-Ouen; Service de pédopsychiatrie du Centre hospitalier de Saint-Denis (ancienne responsable de l’Union de santé mentale de la Bethlehem Arab Society for Rehabilitation en Palestine) : « La santé mentale sous occupation »
- Asja Zaino, doctorante en histoire et anthropologie à l’lNALCO-CERMOM : « Transformer la prison en laboratoire de pédagogie critique: la résistance des prisonnières politiques palestiniennes dans les prisons israéliennes »
12h-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h00 : Table 2. Les Palestinien·nes de l’exil: droits, espaces et appartenances
Modération : Hala Abou Zaki, anthropologue, chercheure indépendante, URMlS/lCM.
lntervenants :
- Jalal al-Husseini (visio), chercheur associé à l’lFPO Amman : « Le statut des réfugiés palestiniens dans les pays arabes entre attachement au droit au retour et diasporisation »
- Hadeel Fawadleh, professeure à l’Université de Birzeit, Palestine : « Les Palestinien.nes dans la diaspora: histoire, chiffres et conditions »
- Johann Soufi, ancien chef du bureau juridique de l’UNRWA à Gaza : « L’UNRWA, en attendant la paix »
- Ismael Sheikh Hassan (visio), chercheur indépendant et urbaniste : « Urban Planning and Post-War Reconstruction in Palestinian Refugees Camps »
16h00-16h30 : Pause café
16h30-18h00 : Table 3. Les productions intellectuelles, culturelles et artistiques en Palestine
Modération : Nicolas Puig, anthropologue, directeur de recherches à l’lRD – URMlS.
lntervenant·es :
- Thomas Michel (visio), doctorant en anthropologie à l’université Paris Cité : « La scène techno en Palestine : des espaces de l’occupation »
- Saadia Agsous, chercheure à L’Observatoire des Mondes Arabes et Musulmans (OMAM), Université libre de Bruxelles : « La littérature palestinienne, entre esthétiques, exil, guerre et mort »
- Najla Nakhlé-Cerruti, chercheure au CNRS (lREMAM) : « Dépasser les contraintes pour faire du théâtre en Palestine »
- Sbeih Sbeih, chercheur associé à l’lnstitut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans : « Nouvelle condition littéraire en Palestine post-Accords d’Oslo »
18h00 : Clôture
Edouard Kaminski, Président de l’université Paris Cité
Depuis plusieurs mois, la bande de Gaza est de nouveau au centre de l’actualité. Alors que la Cour internationale de Justice reconnaît qu’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable – à travers le crime de génocide – soit réalisé contre les Palestinien·nes de Gaza, l’État israélien massacre des dizaines de milliers de civil·es palestinien·nes, bombarde des villes entières, détruit infrastructures et écosystèmes, entrave l’acheminement de l’aide humanitaire et accélère la colonisation dans le reste des territoires occupés. ll invoque comme justification les attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre 2023 au cours desquelles 1 200 lsraélien·nes ont été tué·es et 240 pris·es en otage. Cette catastrophe a des conséquences sur la totalité des habitant·es de la Palestine historique – non seulement dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au sein de l’État d’lsraël – mais aussi dans les camps de réfugié·es palestinien·nes de la région.
Les destructions multiples qui se produisent sous nos yeux rappellent les conditions sociales de la précarité des vies palestiniennes. Les rebondissements internationaux, eux, font apparaître la nécessité d’analyses interdisciplinaires et approfondies, se basant sur des sources multiples, s’appuyant sur des terrains de recherche de longue durée et allant au-delà des attaques en cours.
Cette journée d’étude a pour but de répondre à ces constats. Elle réunit des chercheur·es, juristes, historien·nes, sociologues, anthropologues, et psychiatre, qui interviendront sur trois axes majeurs : la réflexion sur les conséquences juridiques, économiques, mentales et sociales de la colonisation et de l’occupation israéliennes ; le statut, les géographies et les formes d’organisation des réfugié·es palestinien·nes, ainsi que le rôle de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) ; les productions intellectuelles, culturelles et artistiques en Palestine.
Coordination : Hala Abou Zaki ; Mariangela Gasparotto ; Thomas Michel ; Nitzan Perelman ; lnsaf Rezagui.
Comité d’organisation : Hala Abou Zaki ; Mariangela Gasparotto ; Thomas Michel ; Nitzan Perelman ; Nicolas Puig ; lnsaf Rezagui ; Jérôme Tadié ; Louise Virole.
À lire aussi

MobiDocSH, un financement de mobilité doctorale internationale en S&H
Financé par la Faculté Sociétés et Humanités, le programme MobiDocSH a pour objectif de soutenir des projets de mobilité internationale en début de thèse, afin de favoriser l’ouverture internationale du parcours doctoral. Quels projets ? En 2026, la Faculté Sociétés...
![[Appel à participation] 2ᵉ Forum de la ludopédagogie](https://www-test.u-pariscite.fr/societes-humanites/wp-content/uploads/sites/20/2025/12/Forum-ludopédagogie1-1080x675.jpeg)
[Appel à participation] 2ᵉ Forum de la ludopédagogie
Porté par le Pôle Innovation Pédagogique de l’Université Paris Cité, le Forum de la ludopédagogie met à l’honneur le jeu comme levier d’apprentissage et d’innovation pédagogique.

La Faculté S&H célèbre Noël avec ses étudiantes et étudiants en échange !
Mercredi 10 décembre, une quarantaine d’étudiantes et étudiants internationaux en échange ont célébré noël ensemble lors d’un événement organisé dans les locaux de la Faculté Sociétés & Humanités. Au programme : une ambiance chaleureuse avec feu de cheminée,...

Jane Austen, pourquoi un tel succès aujourd’hui ? Ariane Hudelet sur France Culture
Ariane Hudelet est professeure de culture visuelle à l’UFR d’Etudes Anglophones et membre de l’UMR ECHELLES.
