Apprendre par et sur le terrain est au cœur de la formation en géographie mais aussi en sciences de la vie et de la terre. Mais dans le contexte sanitaire actuel, emmener les étudiants sur le terrain n’est pas toujours possible. Deux enseignantes chercheuses d’Université Paris Cité et de l’université de Hambourg ont décidé de pallier cette contrainte en développant des excursions virtuelles à visée pédagogique dans le cadre du projet Virt-Ex.

Le projet Virt-Ex est porté par Sandra Sprenger, responsable du département de didactique de la géographie de l’université de Hambourg en collaboration avec Caroline Leininger-Frézal, responsable du parcours histoire géographie du master de didactique des sciences d’Université Paris Cité. Il vise un double objectif : développer un cadre théorique pour l’excursion virtuelle et expérimenter l’usage de ces excursion virtuelle pour développer des compétences disciplinaires et numériques.
Caroline Leininger-Frézal résume la naissance du projet : « nous avions déjà beaucoup échangé en amont : Sandra Sprenger est venue un an à Paris dans le cadre d’un congé recherche et je suis partie en mobilité Erasmus à Hambourg. Quand le COVID est arrivé, emmener sur les étudiants sur le terrain est devenu difficile. Développer un projet de recherche-action autour du terrain virtuel nous a semblé évident. »
Virt-Ex a démarré en octobre 2020 avec une réunion de lancement pendant lequel les étudiants des deux universités ont pu faire connaissance et découvrir le projet. Chaque équipe a ensuite commencé à travailler de son côté, notamment en se formant aux outils techniques puis en choisissant des terrains et en recueillant des données. Puis lors du séminaire du 22 au 26 février 2021, les étudiants se sont rencontrés tous les jours pour élaborer les excursions virtuelles mais aussi échanger autour de la thématique principale du projet qui est la ville durable.
Expérimenter des excursions virtuelles pour développer ses compétences professionnelles
Tout au long de l’année, les étudiants ont développé des compétences numériques pour concevoir les excursions virtuelles : ils se sont initiés aux systèmes d’informations géographie et à la cartographie numériques, ils ont appris à utiliser les outils spécifiques (Arcgis on line et les Storymaps), ils ont approfondi leurs connaissances en didactique notamment la démarche de la géographie expérientielle apprise en cour. Enfin, le contexte interculturel du projet a permis aux étudiants des deux pays de découvrir leur système éducatif respectif, d’échanger sur le curriculum, les pratiques d’enseignement mais aussi sur la manière de penser la ville durable de part et d’autre du Rhin.
Les excursions virtuelles créées sont actuellement en cours d’expérimentation auprès d’autres étudiants (non impliqués dans le projet initial) au sein d’Université Paris Cité (licence d’histoire et de géographie, licence Professorat des écoles) et au sein de l’université de Hambourg en Bachelor. Par ailleurs, les étudiants qui ont créé les excursions vont les tester dans leur propre classe – le master en didactique des sciences forme des enseignants – le projet participe ainsi pleinement à leur développement professionnel.
Une démarche unique d’apprentissage de la géographie par l’expérience
Le groupe Pensée Spatiale de l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) d’Université Paris Cité a modélisé une démarche d’apprentissage de la géographie qui part de l’expérience des étudiants : c’est la démarche des 4i (Immersion, Interaction, Institutionnalisation, Implémentation), qui a été mise en pratique au sein du projet Virt-Ex.
« Nous construisons tous des savoirs sur l’espace que nous utilisons pour nous déplacer, nous orienter et nous avons des représentations, via les médias sur des espaces qui nous sont inconnus, mais ces savoirs d’expérience sont rarement mis en lien avec les savoirs que nous souhaitons transmettre aux étudiants ou aux élèves », explique Caroline Leininger-Frézal. « Pour réaliser les excursions virtuelles, nous avons d’abord demandé aux étudiants de choisir un espace urbain dans lequel il y a des enjeux de durabilité. Cela pouvait être un éco-quartier, un quartier en rénovation urbaine par exemple. Nous leur avons demandé de réaliser une visite sensible. C’est une visite pendant laquelle ils notent ce qu’ils observent, sentent, entendent et ressentent. Au cours de la visite, les étudiants collectent également des données : photos, sons, observations. C’est la phase d’Immersion dans laquelle on est confronté à une pratique spatiale. Ensuite, les étudiants ont confronté leur expérience du lieu à celles des autres étudiants qui avaient arpenté le même espace virtuellement ou bien physiquement. La confrontation d’expériences différentes correspond à la seconde phrase de la démarche à savoir l’Interaction. Ces discussions ne sont pas gratuites. Elles permettent aux étudiants de construire une vision partagée d’un espace et d’identifier son organisation, ses enjeux. C’est une phase pendant laquelle les étudiants commencent à conceptualiser. Vient ensuite la phase d’Institutionnalisation qui correspond à la formalisation des apprentissages. Dans le projet, l’institutionnalisation est passée par des conférences théoriques et la création des excursions virtuelles par les étudiants. Nous sommes maintenant dans la phase d’Implémentation où les étudiants réutilisent ce qu’ils ont appris dans leur vie professionnelle à savoir avec leurs élèves en classe. »
Le projet n’est pas terminé, les étudiants ont prévu de continuer à échanger sur leurs travaux, et les deux enseignantes-chercheuses envisagent de reproduire l’expérience l’année prochaine en l’élargissant l’expérience à des étudiants en science.
Ce projet bénéficie d’un financement du DAAD, organisme de financement de la recherche en Allemagne.
Les excursions virtuelles déjà réalisées :
En savoir plus
À lire aussi
![[NOUVEAU] Préparation au concours de Conseiller Principal d’Éducation accessible dès la L3](https://www-test.u-pariscite.fr/societes-humanites/wp-content/uploads/sites/20/2026/02/visuel-prepa-concours-CPE-Web-1080x675.jpg)
[NOUVEAU] Préparation au concours de Conseiller Principal d’Éducation accessible dès la L3
La Faculté Sociétés & Humanités renforce son engagement en faveur de la réussite étudiante en proposant une préparation au concours de Conseiller Principal d’Éducation (CPE). Financée par la faculté et portée par des enseignantes-chercheures et...
![[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »](https://www-test.u-pariscite.fr/societes-humanites/wp-content/uploads/sites/20/2026/02/couvertures-livres1-1080x675.jpg)
[Université Paris Cité Éditions] Deux nouveaux ouvrages dans la collection « Démêlés »
Révéler le travail invisible qui fait tenir nos sociétés et affirmer la liberté de la recherche face à la répression : tels sont les enjeux explorés dans Le cœur du capital. Ces travailleuses de l’ombre qui font tourner le monde, de Fanny Gallot et Hugo Harari-Kermadec, et de Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, de Pınar Selek. Parus le 6 février 2026 dans la collection Démêlés.

Unlock Tech Transfer: une série de vidéos pour comprendre le processus d’innovation et le transfert de technologie
Le transfert de technologie reste souvent méconnu ou entouré d’idées reçues qui peuvent freiner l’innovation issue de nos laboratoires. Inscrite dans le cadre du projet ValoCité, Unlock Tech Transfer est une série de vidéos, qui a justement pour objectif d’apporter aux scientifiques un éclairage sur les étapes clés du processus d’innovation, des conseils pratiques et des témoignages d’experts qui sont à leur service au quotidien.
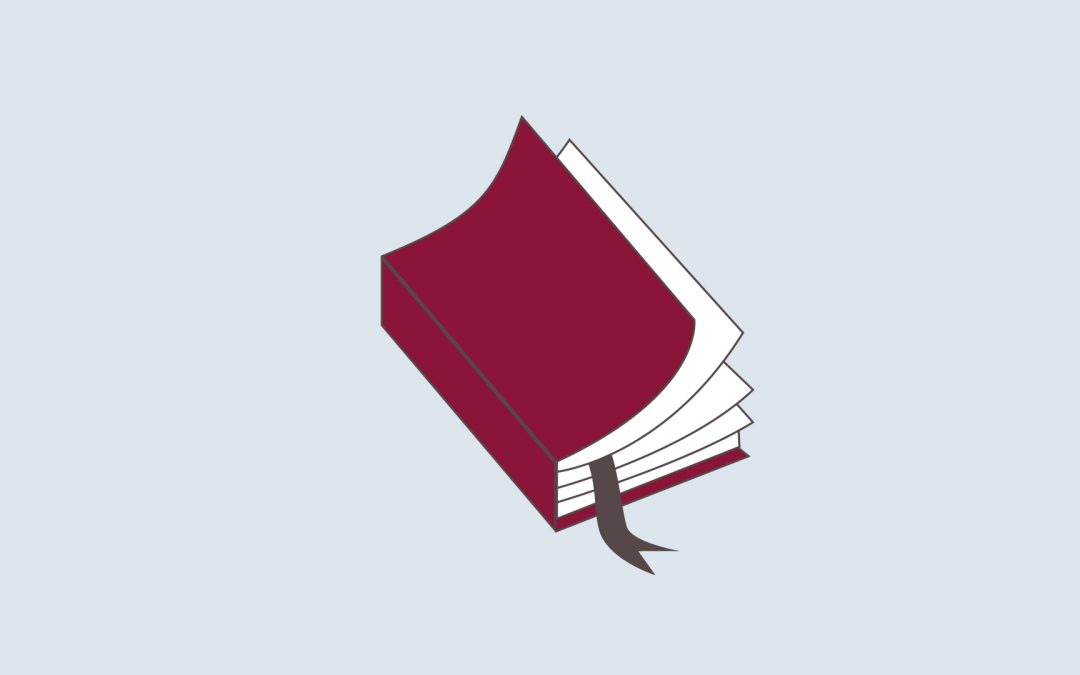
La ville sous cloche ? Zéro Artificialisation Nette, densification et patrimoines culturels
Mathieu Gigot est géographe de formation,enseignant-chercheur en urbanisme et membre de l'UMR Géographie-cités. Malgré certaines contestations politiques récentes, les exigences de sobriété foncière et du ZAN (zéro artificialisation nette)...
