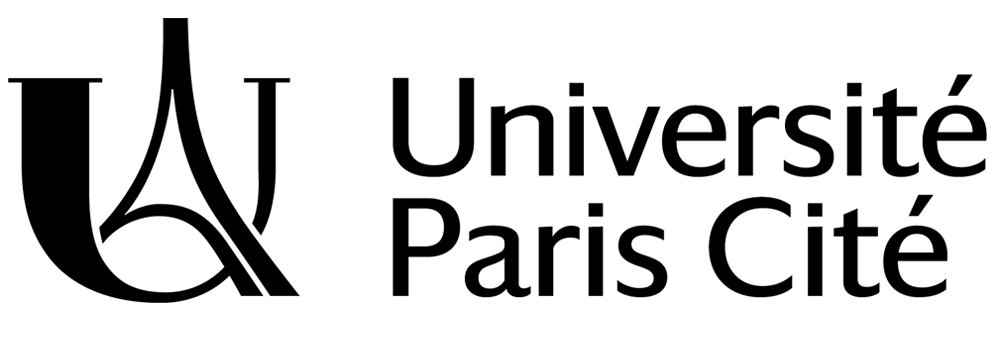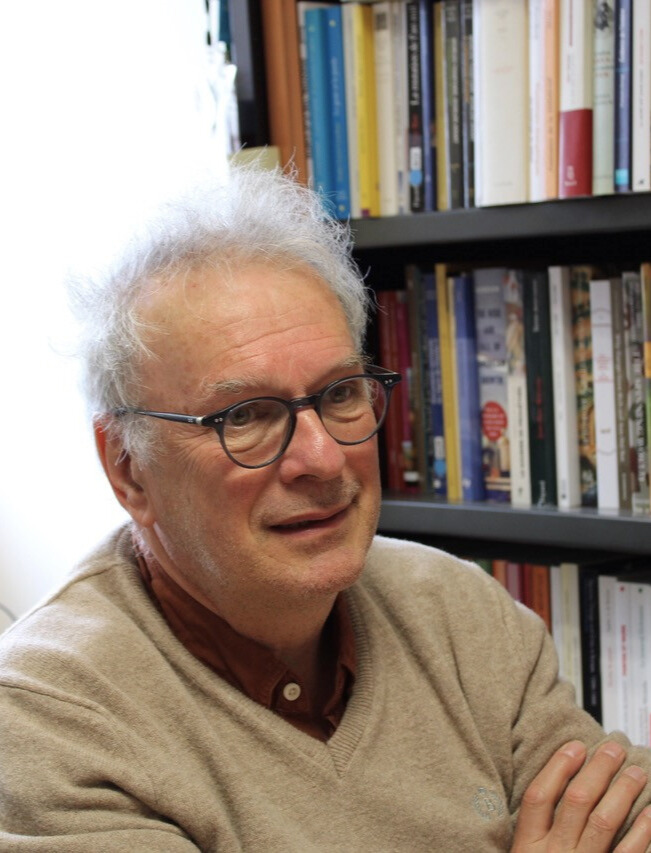Mathieu Arnoux, lauréat de la Médaille de l’engagement de l’Université Paris Cité
Mathieu Arnoux est historien médiéviste, spécialiste de l’histoire économique et sociale de l’Europe préindustrielle. Ancien élève de l’École normale supérieure (1980-1985) et agrégé d’histoire (1985), il a soutenu en 1990 à l’EHESS une thèse de doctorat consacrée à la production et au commerce du fer en Normandie au Moyen Âge. En 1997, il obtient son habilitation à diriger des recherches en histoire médiévale à l’Université Paris 7.
Il commence sa carrière d’enseignant à l’université de Caen et dans l’enseignement secondaire, puis est élu maître de conférences à l’université Paris 7-Denis Diderot en 1991. Il y devient professeur d’histoire médiévale en 1998. Depuis 2001, il est également directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), où il anime un séminaire sur le travail et l’industrie dans l’Europe préindustrielle.
Mathieu Arnoux a été membre senior de l’Institut universitaire de France de 2008 à 2013. Il a dirigé de nombreux programmes de recherche, notamment le projet ANR ENPrESa sur les compagnies marchandes Salviati à la fin du Moyen Âge, et a exercé d’importantes responsabilités scientifiques et administratives, notamment comme directeur du Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain (LIED, UMR 8236, CNRS-Université Paris-Diderot) de 2015 à 2024 et vice-doyen à la recherche de la faculté Sociétés et Humanités.
Ses recherches portent principalement sur l’histoire du travail, des techniques et des ressources dans l’Europe médiévale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués, parmi lesquels Mineurs, férons et maîtres de forges (1993), Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe-XIVe siècles) (2012, prix Augustin-Thierry de l’Académie française) et Un monde sans ressources. Besoin et société en Europe (XIe-XIVe siècles) (2023).
Il joue également un rôle actif dans la vie éditoriale et scientifique : il a été co-directeur de la revue Le Moyen Âge (2005-2018), président du comité éditorial de la collection « L’Évolution de l’Humanité » aux éditions Albin Michel depuis 2006, et membre de plusieurs comités de rédaction, dont celui la Revue de synthèse.
Ses travaux, explorent les dynamiques de production, d’échange et d’innovation dans les sociétés rurales et urbaines médiévales. Ils mettent également en perspective les enjeux historiques du rapport entre ressources, travail et croissance économique avec les débats contemporains sur l’énergie et la durabilité.
Membre de la Royal Historical Society (depuis 1997) et de l’Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (depuis 2006), il a contribué à la formation de nombreux chercheurs à travers la direction de thèses et de projets collectifs en France comme à l’international.
Entretien
Que représente pour vous la Médaille de l’engagement de l’Université Paris Cité ?
J’ai été élu à l’université Paris 7 en 1991. Mon université a changé de nom à quatre reprises au moins, mais ma fidélité à son égard est inchangée, d’où mon émotion à recevoir cette distinction. Enseignant-chercheur en histoire du Moyen Âge, j’ai toujours pensé que j’étais, tant dans mon enseignement que dans la conduite de ma recherche, avant tout un membre d’une collectivité vivante. Cette médaille est pour moi la reconnaissance de cette fidélité, de cet engagement dans notre institution et dans les communautés qui la composent : laboratoire et faculté en particulier.
Qu’appréciez-vous dans le fait de travailler à l’université, et à l’Université Paris Cité en particulier ?
La discipline est le lieu où se forme chaque enseignant-chercheur; elle peut être aussi un lieu de confinement. Parmi les universités parisiennes, la spécificité de Paris 7, que la création de Paris Cité a su préserver, était la pratique d’une interdisciplinarité effective. J’ai très tôt pris conscience de cette capacité d’ouverture offerte à chacun de ses membres, pour peu qu’il s’y engage avec obstination et sans craindre de perdre son identité disciplinaire.
Quels ont été les moments les plus marquants de votre carrière ?
De son passé militant, Paris 7 avait conservé un vrai sens le l’accueil des chercheurs en début de carrière: la participation à la direction et aux organes de gestion leur était proposée, permettant de prendre la mesure de l’ampleur de l’institution et de son dynamisme: j’ai pu en peu d’année accomplir des fonctions de direction et participer aux conseils. Sans cet engagement initial, que l’Université encourageait vivement, je n’aurais pas pu participer à deux expériences qui sont pour moi marquantes : la construction (à partir de 2010) puis la direction (à partir de 2015) d’un nouveau laboratoire, le LIED, que je tiens pour l’une des expériences d’interdisciplinarité les plus authentiques de ces dernières années; de 2019 à 2024, j’ai été impliqué dans la construction de la faculté « Sociétés et Humanités » de l’université nouvelle résultant de la fusion de Paris Diderot avec Paris Descartes. La participation, dans des conditions parfois très complexes, d’une collectivité nouvelle intégrant deux communautés très différentes dans leurs histoires et dans leurs usages était un défi. Je suis fier d’avoir été l’un des membres de l’équipe facultaire dans cette période si complexe.
Des projets pour la suite ?
Il me reste deux années d’activité (et peut-être quelques-une comme émérite) pour continuer à participer aux activités du LIED : l’expérience montre que la vie d’une collectivité interdisciplinaire, toujours passionnante, est aussi exposée à la méfiance instinctive d’un monde scientifique qui reste effrayé par les pratiques hétérodoxes de l’interdisciplinarité. Aussi longtemps que la communauté du LIED le souhaitera (à mesure de mes capacités) je me tiens à sa disposition.