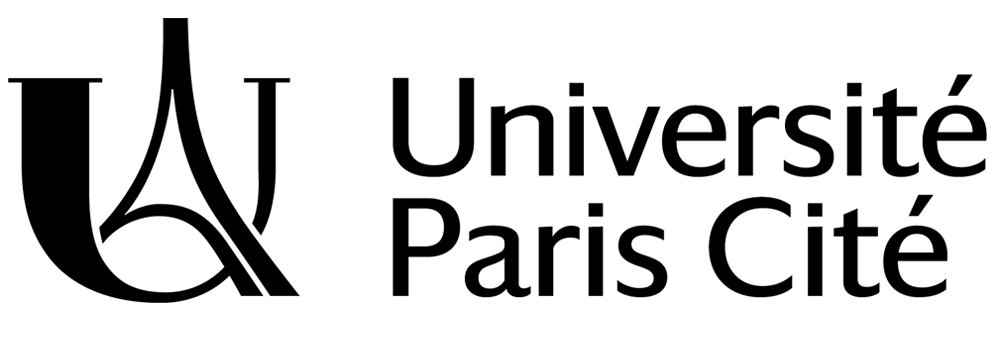Marie-Jeanne Rossignol, lauréate de la Médaille de l’engagement de l’Université Paris Cité
Professeure en Civilisation américaine (États-Unis), Marie-Jeanne Rossignol a effectué toute sa carrière à l’Université Paris Diderot et l’Université Paris Cité.
Née en 1960, elle a suivi des classes préparatoires aux Grandes écoles avant d’intégrer l’École Normale Supérieure de Sèvres, alors en cours de fusion avec l’École normale supérieure d’Ulm, dont elle sort diplômée en 1985. Agrégée d’anglais, elle entame en 1985 un doctorat en histoire et civilisation à l’Université Paris 7 et soutient en 1990 une thèse sur la jeune république américaine. Le livre issu de cette thèse sera récompensé par le Prix Willi Paul Adams de l’Organisation des Historiens Américains.
Nommée professeure à l’Université Paris 7 en 1998, elle consacre ses recherches aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles et s’intéresse à la question de l’esclavage en Amérique du Nord. Elle dirige avec Claire Parfait la collection Récits d’esclaves. En 2022 sa monographie Noirs et Blancs contre l’esclavage est lauréate du Prix Fetkann! Maryse Condé. Engagée dans la recherche collective, elle collabore avec le CIRESC (centre international de recherches sur les esclavages) et contribue à la revue Esclavages & Post-esclavages.
Son travail de recherche entamé à la suite immédiate de la loi Taubira de 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité, lui permet de travailler de concert avec de nombreux chercheurs et chercheuses français.
Son parcours universitaire a également été marqué par un engagement institutionnel important. Vice-présidente du Conseil des Études et de la Vie Universitaire au début des années 2000, elle a accompagné la mise en place du système LMD et contribué à la création du centre de formation des doctorants du PRES Sorbonne Paris Cité. Élue au Conseil d’administration de l’Université en 2012, elle a participé à des commissions stratégiques sur les postes et les moyens, tout en poursuivant son investissement scientifique.
Professeure émérite, elle poursuit aujourd’hui ses collaborations avec le CIRESC, Elle fait également partie du jury du prix Fetkann! Maryse Condé. Fidèle à sa formation d’historienne des jeunes États-Unis, elle continue de s’impliquer dans l’association crée en 2005, Rédheja, le réseau pour le développement européen de l’histoire de la jeune république.
Entretien
Que représente pour vous cette Médaille de l’engagement de l’Université Paris Cité ?
C’est une reconnaissance importante pour moi, mais également pour l’UFR Études anglophones dont je fais partie.
Je suis arrivée à l’université à un moment où le paysage de l’enseignement supérieur était en pleine mutation, et j’ai découvert une université à la veille de la modernisation. En 1999, peu de temps avoir été nommée professeure, j’ai accepté le poste de chargée de mission aux relations internationales au sein de l’équipe présidentielle, après m’être occupée des échanges étudiants dans mon UFR. Ce poste m’a permis d’entrer en contact avec l’équipe présidentielle à un moment où se décidaient le départ du campus de Jussieu pour cause de désamiantage, et la construction du campus des Grands Moulins. Je garde un souvenir ému des discussions en réunion d’équipe du mercredi matin, qui ressemblaient à des d’épisodes de la série « Urgences », alors très à la mode.
En 2002, j’ai été élue vice-présidente du Conseil et de la Vie Universitaire aux côtés du président Benoît Eurin, dont la confiance a été essentielle pour moi. C’était un moment charnière où l’université devait refonder ses formations selon les nouvelles règles du LMD. Il s’agissait d’un tournant majeur sur le plan national : le principe du LMD était aussi de ne pas sanctionner les étudiants mais de leur permettre avancer, avec la possibilité de compenser d’un semestre à l’autre. Ces missions m’ont permis de découvrir le fonctionnement de l’administration. Elles ont cimenté mon engagement et transformé ma pratique d’enseignante-chercheuse. Au sein du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), les semaines étaient intenses et de solides amitiés se sont créées.
En 2012, j’ai été élue au conseil d’administration de l’université. J’y ai occupé plusieurs postes, dont le plus marquant fut la commission des postes, à une époque où l’on débattait des postes à l’échelle de toute l’université, puis la commission des moyens, grâce à laquelle j’ai pu m’initier aux questions budgétaires sous la houlette de Véronique Balland, aujourd’hui professeure au département de chimie de l’Université Paris Cité.
Qu’appréciez-vous particulièrement dans le travail au sein de l’université, en particulier l’Université Paris Cité ?
J’aime la liberté de pensée qui règne au sein de la communauté universitaire. Lorsque j’ai intégré le master 2 d’Études anglophones à l’Université Paris 7, les professeurs, les américanistes, étaient pour la plupart très ancrés à gauche. Je venais de l’École normale supérieure de Sèvres où l’atmosphère était un peu terne juste avant la fusion avec Ulm et j’ai beaucoup apprécié l’ébullition intellectuelle qui régnait à l’UFR. J’étais également la première normalienne à s’inscrire en M2 d’études anglophones à Paris 7. Je n’avais pas le profil classique et pourtant j’ai été très bien accueillie. J’ai découvert un autre monde. J’ai aimé la tolérance, l’ouverture d’esprit et la curiosité qui régnaient au sein de l’UFR, ainsi que l’esprit critique et le sérieux de pensée. Nous brisions les codes en permanence. J’ai bénéficié, dans mon travail sur les États-Unis, d’une grande liberté critique.
Quels ont été les moments les plus marquants de votre carrière ?
D’un point de vue académique, mon travail sur l’esclavage m’a valu une reconnaissance de la communauté scientifique.
J’ai bénéficié de deux projets IdEx. Le premier a aidé au financement de la collection « Récits d’esclave » que je dirige avec ma collègue Claire Parfait. Cette série de traductions a été sélectionnée ce printemps pour figurer sur la plateforme « OpenEdition », la rendant ainsi accessible à un large public. Nous avons également édité une anthologie d’historiens américains-africains. Le deuxième IdEx porte sur les travaux sur les liens entre la race et la démocratie. Avec Michaël Roy, professeur au département d’études anglophones, et l’aide de Cécile Roudeau, autre professeure du département, nous avons publié en 2023 une Anthologie de la pensée noire qui est une anthologie de textes d’auteurs états-uniens et haïtiens jamais traduits.
En 2022, j’ai publié une monographie, Noirs et Blancs contre l’esclavage. Une alliance antiesclavagiste ambiguë 1754-1830, qui a obtenu le prix Fetkann ! Maryse Condé.
Le travail de recherche, que j’avais entamé à la suite immédiate de la loi Taubira de 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité, m’a permis de collaborer avec de nombreux chercheurs et chercheuses français et d’être en relation avec l’espace public.
Des projets pour la suite ?
J’ai entamé un travail sur Tocqueville et l’Amérique avec l’un de mes anciens doctorants, maintenant enseignant-chercheur. Ce projet propose une relecture de l’ouvrage De la démocratie en Amérique de Tocqueville, en le resituant dans son contexte et en proposant une vision historicisée et un regard critique sur ce livre qui en révèle la complexité.
Lorsque le récit de Tocqueville paraît, en 1835, il connaît un grand succès en Europe. Les lecteurs d’aujourd’hui ont tendance à ne retenir que son enthousiasme pour la démocratie américaine sans bien comprendre que l’ouvrage évoque aussi une face bien plus sombre de la jeune république. En 1830, l’Indian Removal Act est notamment promulgué : les Indiens sont chassés vers l’ouest, ce qui entraînera la mort de milliers d’entre eux, de fatigue, de froid, de maladie et de faim. Le président Andrew Jackson, à l’origine de cette loi, est l’un des maîtres à penser de Donald Trump.
Je suis également de près les travaux de la Fondation de la mémoire pour l’esclavage où je siège au conseil scientifique. C’est un projet à l’interface des associations et du milieu scientifique.
J’ai été professeure jeune, à 38 ans. J’ai eu des doctorants dont certains sont professeurs aujourd’hui. La direction de thèses est une expérience très gratifiante. Au fil des années, on est passé d’une direction distante à un suivi plus impliqué. C’est une aventure humaine qui requiert de la souplesse et de la ténacité et qui m’a permis de rencontrer des personnes merveilleuses.