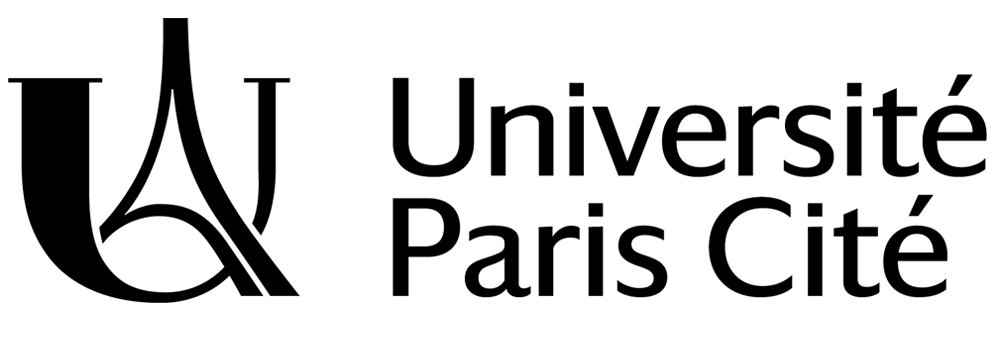2025 est l’année internationale des sciences et technologies quantiques. Dans ce cadre, l’Université Paris Cité revient sur des actions importantes en lien avec le quantique menées en son sein. L’informatique quantique et la physique quantique sont aujourd’hui des disciplines scientifiques majeures mais complexes à comprendre. Pour faciliter leur compréhension auprès de publics non experts, Sophie Laplante, enseignante-chercheuse en algorithmique et en complexité du calcul quantique et classique à l‘IRIF – Institut de Recherche en Informatique Fondamentale (UPCité/CNRS) – et nommée membre sénior à l’IUF en 2025 au titre de la chaire Médiation scientifique, conçoit des objets pédagogiques. Du côté de la physique quantique, Gautier Depambour, post-doctorant en histoire des sciences au laboratoire SPHERE – Sciences, Philosophie, Histoire des sciences (UPCité/CNRS/Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) – et MPQ – Matériaux et Phénomènes Quantiques (UPCité/CNRS) – a quant à lui collaboré avec le physicien et Prix Nobel de physique 2022 Alain Aspect sur l’ouvrage intitulé Si Einstein avait su paru en 2025 aux éditions Odile Jacob.

Photographie d’un atelier sur l’informatique quantique organisé dans le cadre du projet QuBOBS.
Pouvez-vous présenter un de vos projets de médiation et de vulgarisation ?
Sophie Laplante : Je travaille actuellement sur QuBOBS, un projet débuté en 2020 à l’IRIF que je mène en lien avec une designer, un compositeur et une ingénieure en informatique pour produire des objets pédagogiques. Ce projet vise à développer une panoplie d’objets numériques et physiques pour enseigner les bases de l’informatique quantique : qubit, superposition, enchevêtrement. Mon but est de concevoir des outils pour les médiateurs. Je travaille notamment avec l’équipe pédagogique du Palais de la découverte.
Gautier Depambour : J’ai contribué à l’ouvrage intitulé Si Einstein avait su écrit par Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022 pour son expérience montrant la violation des inégalités de Bell. En partant du début du XXème siècle, le livre retrace l’histoire de la mécanique quantique à travers les contributions d’Einstein. Ce livre qui possède plusieurs niveaux de lecture s’adresse à un large public.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser au quantique ?
SL : J’ai suivi une formation en informatique classique à la fin des années 1980. A cette époque l’informatique quantique n’était pas aussi bien perçu qu’aujourd’hui car il s’agissait d’un champ de recherche nouveau et peu de scientifiques y voyaient un intérêt. Les étudiantes et étudiants de ma promotion ont réalisé les premières thèses en informatique quantique, ce qui m’a encouragé à m’y intéresser en parallèle de ma thèse en informatique classique. J’ai ainsi été amenée à travailler avec des personnes qui étaient les premières à s’intéresser à comment l’informatique quantique peut améliorer l’informatique classique.
GDP : J’ai commencé à véritablement m’intéresser à la physique quantique durant la première année de mon cursus d’étude d’ingénieur à CentraleSupelec. A la fin de ce cursus, j’ai décidé de m’intéresser davantage à l’histoire des sciences. Sous la co-direction d’Olivier Darrigol, directeur de recherche au laboratoire SPHERE, et d’Alain Aspect, j’ai effectué une thèse sur l’histoire de l’optique quantique, un champ de recherche aujourd’hui en plein essor. L’objectif de ma thèse était de comprendre comment la communauté de l’optique s’est convaincue de la nécessité d’utiliser la mécanique quantique pour décrire la lumière.
Comment en êtes-vous arrivés à mener des actions de médiation et de vulgarisation sur ces sujets ?
SL : J’ai commencé à m’intéresser à la médiation au cours de mon expérience d’enseignante en informatique. Afin d’expliquer certaines notions du calcul quantique, j’ai conçu petit à petit des objets pédagogiques. C’est ce qui m’a amenée à développer le projet QuBOBS dont le but est justement d’accompagner les actions de médiation par la conception d’objets pédagogiques.
GD : Durant mes études à CentraleSupélec j’ai écrit dans le PIAF, le journal publié dans cette école. Parallèlement à mon cursus d’ingénieur, j’ai poursuivi d’autres projets de vulgarisation scientifique comme l’écriture d’Une journée au cern, un livre pensé comme une visite de cet organisme dans lequel j’ai effectué cinq mois de stage. J’ai aussi rédigé des articles dans Science & Vie ce qui m’a permis d’acquérir une expérience journalistique, spécifiquement dans la vulgarisation scientifique.
Comment faites-vous pour vulgariser des sujets aussi complexes que l’informatique quantique et la physique quantique ?
SL : J’essaie toujours de rester sur des idées simples et de me baser sur des représentations visuelles. J’utilise principalement des objets en papier. Ils peuvent servir à expliquer diverses notions telles que l’intrication quantique qui suggère que deux états quantiques sont conditionnés entre eux. Je m’adresse aussi bien à des lycéennes et des lycéens qu’à des personnes plus âgées. L’idée n’est pas forcément de susciter un intérêt mais de mieux expliquer des concepts à des personnes qui ne les auraient pas forcément bien compris.
GD : La mécanique quantique est une théorie contre intuitive et selon moi l’histoire est le meilleur moyen de vulgariser ce sujet. Avec Si Einstein avait su, l’idée est justement de raconter une histoire et d’introduire des concepts de façon chronologique pour comprendre les différentes étapes de leur construction et leur évolution.
Le saviez-vous ?
L’équipe Algorithmique et Complexité de l’IRIF et le laboratoire MPQ forment aujourd’hui deux communautés menant notamment des actions sur l’informatique quantique et sur la physique quantique.
Cliquer ici pour en savoir plus
L’IRIF et le MPQ portent tous les deux des projets d’innovation en lien avec le quantique.
Cliquer ici pour en savoir plus
Des chercheuses et chercheurs de l’Université Paris Cité ont participé à une série de vidéos sur l’intrication quantique sur la chaîne YouTube Photons Jumeaux.
Cliquer ici pour en savoir plus
Découvrez le premier épisode de la série ici
À lire aussi

La semaine du cerveau 2026 à l’Université Paris Cité

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...

Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation
L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...

Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité
Créé en décembre 2023, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...