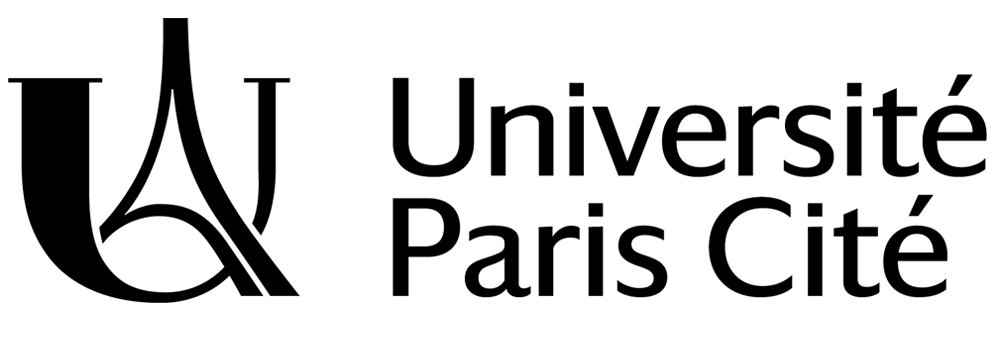Titulaire de la Chaire UNESCO « Enseignement supérieur pour le développement durable en Afrique » de l’Université de la Manouba en Tunisie, Jouhaina Gherib est également vice-présidente de l’association internationale des universités créée sous l’égide de l’UNESCO en 1950. En visite à l’Université Paris Cité, elle renforce sa collaboration avec la Graduate School* Sustainability, Organisations and Institutions, partenaire de la Chaire, autour de la responsabilité sociétale des organisations. Aujourd’hui, elle revient sur les grands axes de la Chaire, les initiatives déployées et les pistes de collaboration entre l’Université de la Manouba et UPCité.

A gauche, Jouhaina Gherib, titulaire de la Chaire UNESCO et Petia Koleva, à droite, responsable de la Graduate School Sustainability, Organisations and Institutions.
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de la Chaire UNESCO « Enseignement supérieur pour le développement durable en Afrique » de l’Université de la Manouba (UMA) ?
Cette Chaire UNESCO vise à former, sensibiliser et produire des connaissances autour de la responsabilité sociétale des organisations en Afrique. La recherche dans ce domaine gagnerait à être davantage développée dans les pays africains et dans le Sud de façon générale, et ceci ne peut que se renforcer et gagner en visibilité à travers la coopération internationale. L’idée de la Chaire, c’est de former des jeunes pour qu’ils soient plus responsables en Afrique et au-delà de l’Afrique et de faire en sorte que cette nouvelle génération soit plus sensibilisée, plus active dans le domaine du développement durable. La Chaire permet de faire un bilan de tout ce qui a été fait jusque-là et d’intégrer un peu plus l’enseignement supérieur dans ce qui va être défini pour les générations futures dans les prochaines échéances des Nations Unies. Donc la Chaire cherche aussi à ce que l’enseignement supérieur soit plus présent, que les jeunes soient plus présents, que l’Afrique soit plus présente et que leurs voix soient entendues au plus haut niveau.
Quels sont les principaux volets de la Chaire et comment s’inscrivent-ils dans le partenariat avec la Graduate School Sustainability, Organisations and Institutions d’UPCité ?
Côté recherche, nous travaillons sur les dynamiques de transformations des organisations face aux enjeux de durabilité. Or, c’est un sujet sur lequel je travaille avec Petia Koleva, responsable de la Graduate School Sustainability, Organisations and Institutions et Amel Ben Rhouma, co-responsable de la Graduate School Sustainability and Transitions. C’est donc très naturellement que nous avons pensé à la Graduate School Sustainability, Organisations and Institutions pour s’associer à la Chaire. Côté formation, nous souhaiterions proposer des modules complémentaires dans le domaine de la responsabilité sociétale des organisations au sein de nos deux universités.
L’autre grand volet de la Chaire, c’est le domaine de la vie universitaire. Par exemple, à l’Université de la Manouba, nous avons lancé les clubs développement durable « GREEN UMA » qui regroupent l’ensemble des étudiantes et étudiants engagés de l’université. Nous voulons créer des cellules au niveau des quinze établissements de l’université pour que les étudiantes et étudiants élaborent eux-mêmes leur plan d’action sur trois ans, et puissent réfléchir à comment sensibiliser autour d’eux et mettre en place des actions concrètes sur leurs campus. Je pense que plusieurs initiatives d’UPCité pourraient venir se rajouter à ce que nous sommes en train de faire. J’encourage la collaboration entre les étudiantes et étudiants des deux universités, notamment à travers des projets communs pour qu’ils puissent ensemble, en tant que jeunes de la même génération, même de milieux différents, faire en sorte de résoudre des problèmes qu’ils vont être amenés à résoudre conjointement dans un avenir qui n’est pas si lointain.
Donc la Chaire est une belle plateforme parce qu’elle est construite sur une relation de confiance entre les enseignantes et enseignants de la Chaire un peu partout dans le monde. Il va falloir, avec cette confiance, donner le relai aux étudiantes et étudiants qui vont pouvoir nous aider à préciser ce qui doit être fait sur le terrain et à imaginer un futur. Je suis convaincue que cela doit être fait dans tous les pays du monde et je suis ravie que cela puisse se faire dans nos deux universités à travers ce partenariat.
Pouvez-vous nous parler des activités de la Chaire en cours et quels sont les projets communs envisagés ?
Sur le volet recherche, nous continuons à travailler sur les dynamiques de transformations des organisations face aux enjeux de durabilité dans une perspective comparative internationale. Nous entamons également un travail de recherche sur l’histoire des institutions. Une équipe travaille sur l’histoire de l’Université Africaine parce que ce n’est pas connu du tout. Peu de personnes savent par exemple que les plus vieilles universités du monde encore en activité se trouvent en Afrique et plus spécifiquement en Tunisie (Université Ezzitouna, 737), au Maroc (Université al Qaraouiyine, 859), et en Egypte (Université Al Azhar, 970). L’idée, c’est de retracer l’histoire des universités africaines et de montrer que ça ne date pas d’hier ; même si aujourd’hui les universités n’ont pas réellement la capacité de transformer leur société pour de multiples raisons, entre autres, toute la phase de colonisation qui a un peu ralenti ce développement.
Sur le plan de la formation, nous souhaitons lancer un master d’études africaines à l’Université de la Manouba. Il existe déjà un master dans une autre université tunisienne, nous créerons donc le deuxième. C’est un projet très prometteur parce que nous voulons montrer ce que les études africaines peuvent réellement apporter à l’Afrique et au-delà et nous voudrions que cela soit fait avec les compétences africaines sans que celles-ci soient coupées du monde.
Nous avons également des équipes qui travaillent sur un plaidoyer qui pourrait être proposé aux pouvoirs publics de nos pays, puis au niveau continental et puis au niveau des Nations Unies, sur l’enseignement supérieur après 2030. La voix de l’enseignement supérieur n’a pas été assez entendue jusque-là, l’université est interpellée sur certains des objectifs de développement durable (ODD) de façon transversale. L’idée, c’est de faire en sorte d’être une force de frappe pour dire que le prochain agenda ne peut pas se faire sans les universités. Il faut faire entendre les voix des universités, dans leur diversité et dans leur complémentarité. Voix du Sud, voix du Nord, sciences humaines, sciences exactes. C’est un travail que nous devons faire pour être plus audible auprès des décideurs publics et la chaire UNESCO en fait un de ses objectifs.
Quelles sont les pistes de collaboration entre UPCité et l’Université de la Manouba ?
Un projet de mobilité entre nos deux universités est en discussion. L’idée, c’est de recevoir des étudiantes et étudiants de l’Université Paris Cité et de ne pas uniquement envoyer des étudiantes et étudiants du sud vers le nord. Je pense qu’il faut renforcer les mobilités et œuvrer pour un meilleur équilibre dans ce domaine. Les étudiantes et étudiants du nord doivent également être sensibilisés à l’importance d’une immersion dans un environnement différent et ils verraient que ce n’est peut-être pas si différent que ça. Il y a des débrouillardises et des choses qui se font dans d’autres pays qui ont tout autant de valeur. Donc c’est important pour les jeunes.
Nos deux universités collaborent depuis 2011. En février dernier, j’ai relancé l’idée de signer une convention entre les deux universités pour définir un cadre légal qui permettrait de mettre en place des choses de façon plus structurée. J’appelle à ce que ce soit concrétisé au plus vite.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes chercheuses et chercheurs, étudiantes et étudiants qui souhaitent contribuer au développement durable dans leur région ?
Moi je crois à la force des petites actions, aux solutions apportées aux petites questions et aux besoins exprimés localement.
Je pense aussi qu’il faut être dans l’empathie et à l’écoute de sa communauté locale pour apporter des réponses concrètes. Ensuite, bien-sûr, ces réponses locales gagneraient à être rattachées à des initiatives plus globales pour pouvoir ensuite avoir des financements, faire de la communication, et se faire connaître. Il faut donc commencer par le local et le rattacher avec le global.
Le changement climatique, c’est important, tout le monde doit y penser, mais pour espérer résoudre le problème du changement climatique au niveau global, des actions dans sa petite région sont utiles. Commencer par résoudre de petits problèmes au niveau local fait gagner en légitimité auprès de la communauté. Apporter une solution concrète à un de ses problèmes, vous fait écouter, entendre et installe la confiance nécessaire pour concrétiser les changements et vaincre les résistances. La confiance est très importante et elle s’obtient avec des réalisations, un discours sincère et de l’écoute. Une fois cette confiance installée et ces réalisations locales mises en place, le montrer pour que ça soit visible est indispensable pour créer un cercle vertueux et rattacher ces actions locales produites au profit de sa communauté à quelque chose de plus global et de plus impactant. Et la coopération internationale est cruciale à ce niveau. La chaire UNESCO en fait un de ses objectifs aussi et compte sur la coopération avec UPCité pour en accélérer la réalisation.
*programme de formation et recherche post-licence incluant master et doctorat
À lire aussi

Prix Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science : Appel à candidatures 2026
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et l'Académie des sciences, déclare officiellement ouvert l'appel à candidatures de l'édition 2026 du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science :...
lire plus
Suivi des maladies chroniques : un patient sur deux serait ouvert à la téléconsultation
L’étude REACTIVE, coordonnée par la Dre Tiphaine Lenfant et le Pr Viet-Thi Tran et menée par des équipes de médecine interne de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, du centre d’épidémiologie clinique de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, de l’Université Paris Cité, de...
lire plus
Le Collège de l’Académie nationale de médecine : une première promotion marquée par l’engagement de l’Université Paris Cité
Créé en décembre 2023, le Collège de l’Académie nationale de médecine se veut être un lieu d’échanges entre les académiciens et des jeunes médecins, chirurgiens, biologistes, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires. Il réunit ainsi 38 jeunes scientifiques, dont 15...
lire plus
Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : ce que dit la recherche
L’Assemblée nationale a adopté, le 26 janvier 2026, la proposition de loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Face aux inquiétudes liées au cyberharcèlement, à l’isolement ou à la désinformation, Grégoire Borst, professeur de psychologie du...
lire plus